| |

 |
Séisme dans la
région de Saint-Dié 22
février 2003 |
 Détection
et localisation lors de la phase d'alerte Détection
et localisation lors de la phase d'alerte
Samedi 22 février 2003 à 21 h 41, heure française
(20:41 TU), un événement sismique de magnitude
Ml=5.9 s'est produit à 21 kilomètres à
l'ouest de Saint-Dié (Vosges). Ce séisme a généré
une alerte sur le réseau de surveillance sismique du
DASE. Le sismoloque d'astreinte, averti automatiquement, a fourni,
35 minutes plus tard, aux autorités responsables, la première
analyse de l'événement. Il a notamment donné
une première estimation de la localisation de l'épicentre
et de la magnitude du séisme.
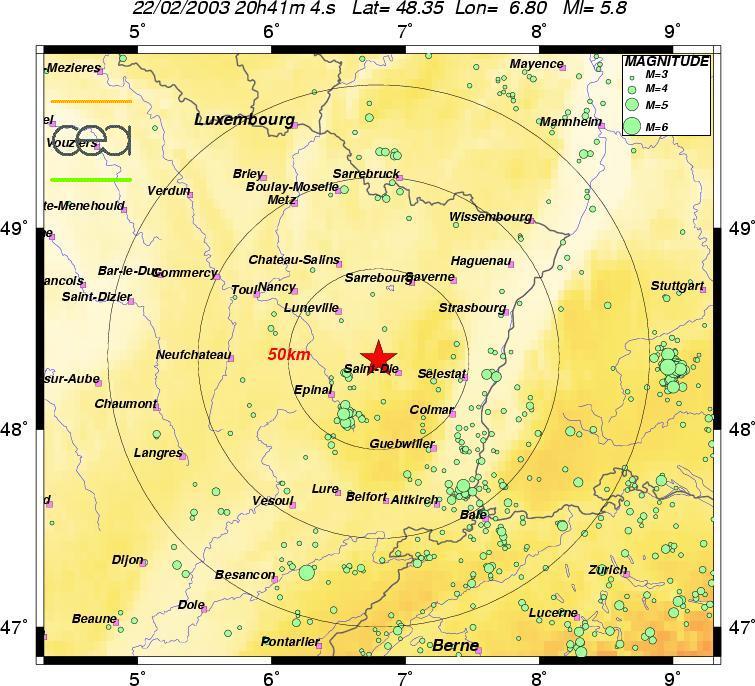
 Localisation préliminaire de l'événement
(les points verts représentent la sismicité naturelle
de la région)
Localisation préliminaire de l'événement
(les points verts représentent la sismicité naturelle
de la région)
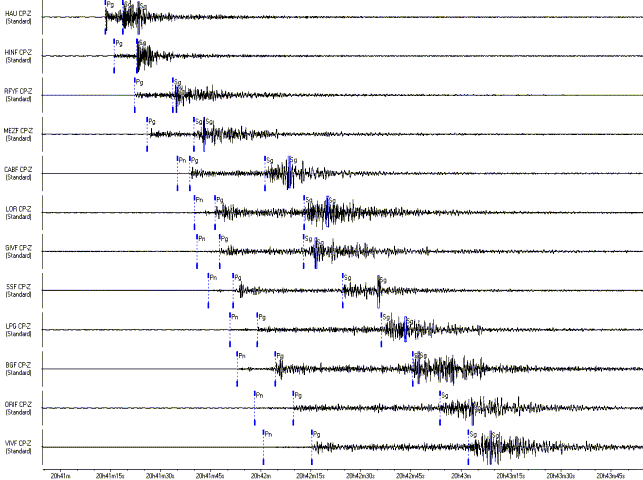
 Signaux associés à l'événement pour
différentes stations du réseau national
Signaux associés à l'événement pour
différentes stations du réseau national
 Caractérisation
et localisation lors de l'analyse de routine Caractérisation
et localisation lors de l'analyse de routine
Une localisation plus précise a ensuite été
effectuée par les analystes sismologues du LDG qui ont
pour tâche de réaliser le bulletin des séismes
proches. Ce travail a surtout permis d'affiner la localisation,
à l'aide de plus de 120 pointés, et d'estimer
les différentes magnitudes associées à
l'événement :
| Date |
22/02/2003 |
| Heure
origine |
20 H 41
MN 06.9 S tu |
| Latitude |
48 DEG 20
MN NORD (48.34) |
| Longitude |
6 DEG 41
MN EST (6.68) |
| Profondeur |
14 km |
| Magnitude |
5.9 (Ml)
magnitude régionale
4.1 (Ms) magnitude de surface
5.0 (Mb) magnitude télésismique |
|
Cette localisation fine montre la diversité de
magnitudes obtenues, chaque magnitude correspondant à
une analyse particulière. La magnitude Ml est communément
utilisée pour caractériser les séismes
locaux.
Dans les 48 heures qui ont suivi l'événement,
cinq répliques majeures, de magnitudes supérieures
à 3, ont pu être enregistrées, générant
plusieurs nouvelles alertes. Plusieurs centaines de petits
événements ont été détectés
grâce à la proximité des stations HAU
et HINF (distance inférieure à 60 Km). Ces répliques
sont habituelles à la suite d'un séisme important.
Cette activité locale a généralement
tendance à diminuer avec le temps, cette décroissance
pouvant s'étaler sur une durée allant de quelques
heures à plusieurs semaines.
Le tableau ci-dessous fournit les caractéristiques
des principaux événements enregistrés
dans les 48 heures qui ont suivi le séisme principal :
|
date
|
heure origine
|
latitude (N) |
longitude (E) |
magnitude (Ml) |
|
22/02/2003 |
20:41:06 |
48.34 |
6.67 |
5.9 |
|
22/02/2003 |
20:54:26 |
48.31 |
6.63 |
3.7 |
|
23/02/2003 |
00:16:43 |
48.31 |
6.63 |
3.3 |
|
23/02/2003 |
14:53:48 |
48.31 |
6.60 |
3.4 |
|
23/02/2003 |
23:58:53 |
48.29 |
6.61 |
3.6 |
|
24/02/2003 |
00:35:43 |
48.30 |
6.62 |
3.3
|
|
La localisation des principales répliques semble indiquer
une migration des événements en direction du sud-ouest.
 Contexte
sismo-tectonique Contexte
sismo-tectonique
Dans le secteur de Saint-Dié, trois directions tectoniques
sont observées (figure ci-dessous) :
 |
 |
La direction N80°, représentée
par le cisaillement de Lalaye - Lubine, trait majeur de
l'orogénèse varisque (qui se prolonge dans
le bassin parisien par la faille de Vittel et la faille
de Bray) ; |
| |
 |
La direction subméridienne
(N10°), axe principal du fossé rhénan,
liée à la distension oligocène que
l'on retouve un peu partout dans le massif vosgien ; |
| |
 |
La direction N130°, marquée
par des failles anciennes qui ont été réactivées
lors de l'exhaussement des Vosges au Mio-Pliocène. |
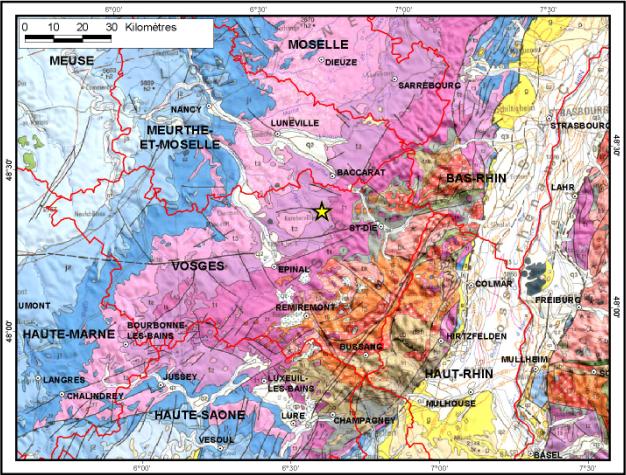
 Contexte géologique régional
Contexte géologique régional
On notera que la sismicité instrumentale et historique
de ce secteur (figure ci-dessous) a permis de mettre en évidence
le caractère actif des directions subméridiennes
notamment dans la région de Remiremont, siège
d'un séisme d'intensité épicentrale VIII
en 1682 et d'une crise sismique en 1984-85 (magnitude 4.8).
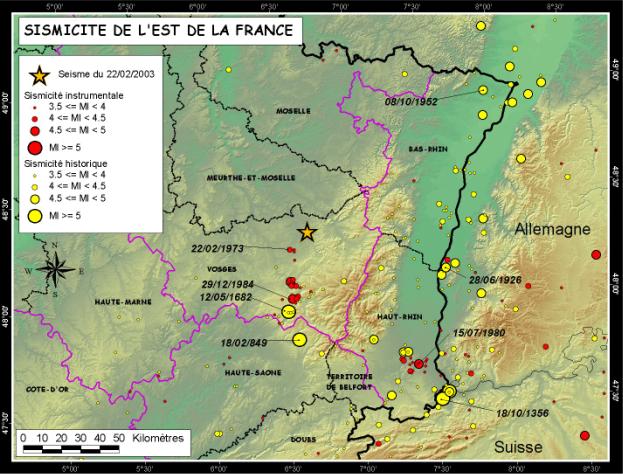
Il n'est pas possible, à la date de rédaction
de cette note, de déterminer précisément
la direction de la faille qui est à l'origine du séisme.
|