| |

 |
Étude du séisme
dans la région d' Alger 21
mai 2003 |
NOTE D'INFORMATION DU
LABORATOIRE DE DETECTION ET DE GEOPHYSIQUE
 Modèle
de source cinématique pour le séisme d'Alger du 21/05/2003 Modèle
de source cinématique pour le séisme d'Alger du 21/05/2003
Cette étude cherche à définir précisément comment le glissement s'est produit sur la faille, générant ainsi le séisme d'alger du 21/05/03.
Basée sur la méthode des patchs (ou zones de glissement) développée
par Vallée et Bouchon (2004), la rupture est décrite
par un ensemble de zones homogènes de glissement. Dans
le cas du séisme d'Alger, 2 patchs suffisent pour assurer une estimation satisfaisante
de la complexité du signal des ondes P. On suppose que l'orientation de la faille est connue (mécanisme fourni par le laboratoire de Harvard) et la profondeur
hypocentrale est fixée à 10km. L'épicentre
est symbolisé par l'étoile sur le plan
de glissement (figure 1). La durée de la source est
d'environ 17s. La figure 2 montre le plan de rupture
en 3D sous la côte algérienne.
 Estimation
des formes d'onde et comparaison aux enregistrements Estimation
des formes d'onde et comparaison aux enregistrements
L'inversion a été effectuée en
utilisant un ensemble de 13 stations du consortium IRIS et
du CEA. La durée du signal inversé est de 28sec
pour la phase P (signaux sur le disque exterieur figure 3) et de 32sec pour la phase SH (signaux à
l'intérieur du disque). L'azimut de chaque
station par rapport à l'épicentre est
indiqué à coté de chaque signal. Le signal
noir correspond à l'enregistrement, le signal
vert à l'estimation en décrivant le glissement
avec un seul patch de glissement et le signal rouge à l'estimation
en décrivant le glissement avec deux patchs.
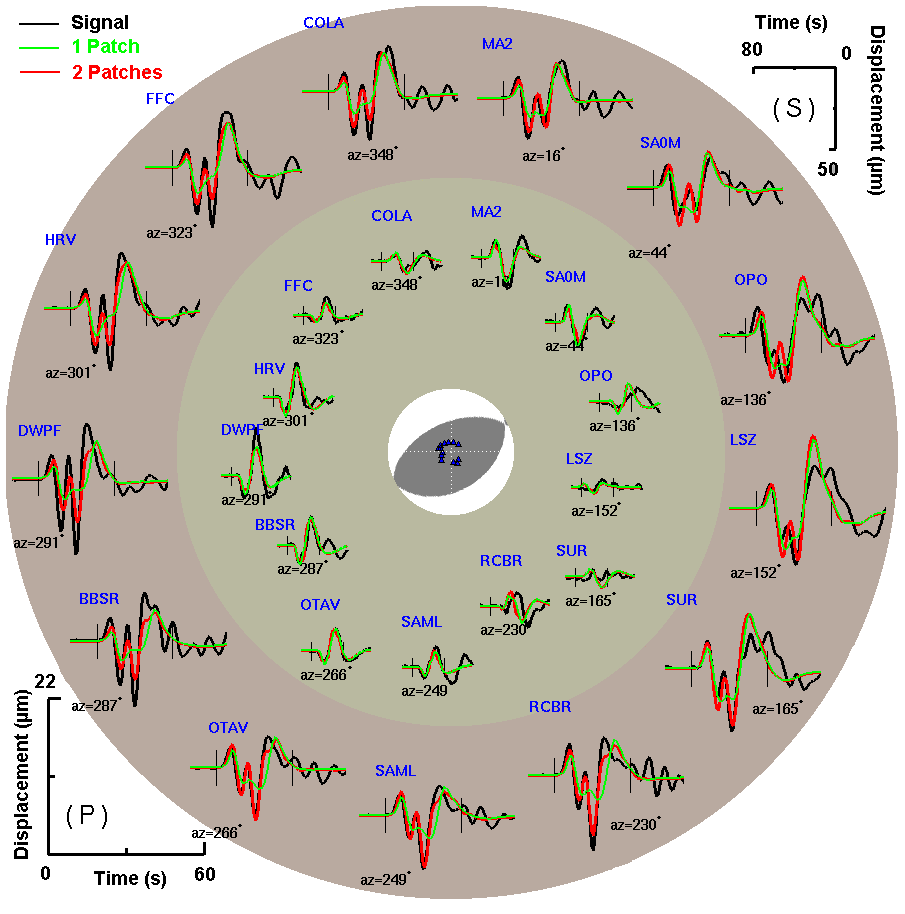 |
 |
Figure 3 |
|
Cette modélisation a permis de valider la géométrie du plan de faille fournie par le laboratoire d'Harvard. De plus, nous avons pu envisager la façon dont le glissement s'est produit sur la faille. La trés bonne similitude obtenue entre les enregistrements réalisés sur les capteurs sismiques et les signaux numériques de cette simulation permet de valider cette description de la rupture sismique.
|