 |
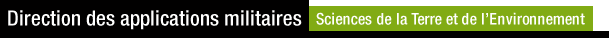 |
 |
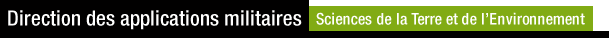 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
L'évaluation de l'aléa sismique |
 |
 |
 |
|
 |
 Aléa
et risque sismiques Aléa
et risque sismiques |
 |
|
 |
Aléa sismique |
 |
|
 |
Evaluer l'aléa sismique, c'est déterminer
la probabilité qu'au cours d'une période de référence, une secousse
sismique atteigne ou dépasse une certaine intensité sur un site. |
 |
|
 |
Risque sismique |
 |
|
 |
Déterminer le risque sismique, c'est calculer
la probabilité et le niveau des dommages
au cours d'une période de référence et dans une région considérée.
Une étude d'aléa sismique comporte deux étapes :
 |

 |
La première porte sur la caractérisation
des sources sismiques en termes de localisation, magnitude
et récurrence. Elle aboutit, à l'issue d'un travail de
synthèse de données géologiques et sismologiques éventuellement,
complété par l'acquisition de données de terrain, à la
réalisation d'un zonage sismotectonique. |
 |

 |
La seconde conduit à la définition
de mouvements du sol de référence qui dépendent à la fois
des sources sismiques potentielles déduites du zonage
sismotectonique, de l'atténuation des ondes et de la configuration
géologique et topographique des sites. |
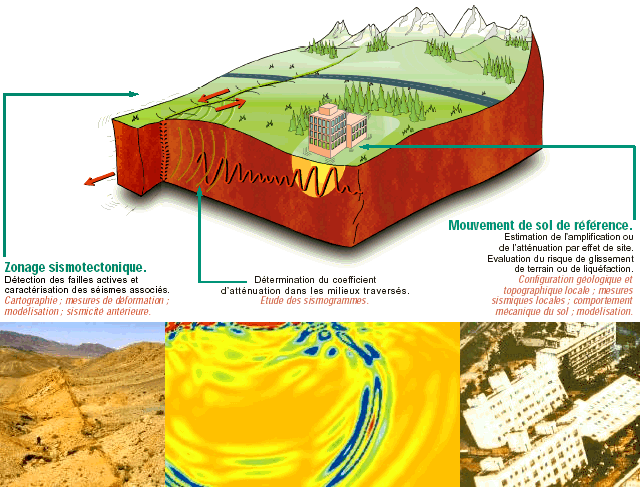
 |
A gauche : faille active
(Mongolie).
Au centre : modélisation de la propagation des ondes sismiques.
A droite : Niigata, Japon, 1964 : les zones les plus sensibles
se sont liquéfiées sous l'effet du séisme, entraînant
le basculement des immeubles. |
Pour mener à bien les études d'aléa sismique qui lui sont confiées,
le Département analyse, surveillance, environnement (DASE)
de la Direction des applications militaires (DAM) conduit ou
participe à des actions de recherche et développement dans différents
domaines. |
 |
|
 |
 Etudes
de source et propagation en champ proche Etudes
de source et propagation en champ proche |
 |
|
 |
Grâce à l'acquisition de données expérimentales
de mouvement fort et à la modélisation numérique, on vise à mieux
comprendre la variabilité du mouvement en champ proche, c'est
à dire dans les zones les plus vulnérables.
La construction d'installations enterrées nécessite également
de mieux comprendre quels sont les paramètres physiques et géologiques
qui conditionnent les variations d'amplitude et de forme des
signaux sismiques avec la profondeur. |
 |
|
 |
 Effets
de site et vulnérabilité Effets
de site et vulnérabilité |
 |
|
 |
Les effets de site, qui sont à même de
modifier considérablement le signal sismique, constituent une
sorte de vulnérabilité naturelle que l'on commence à prendre
en compte dans les réglementations. De nombreuses questions
de fond restent encore en suspend, en particulier l'effet réel
des topographies, l'influence des variations latérales de vitesses
ou le piégeage des ondes dans les bassins sédimentaires. |
 |
|
 |
 Etudes
probabilistes Etudes
probabilistes |
 |
|
 |
La majorité des réglementations actuellement
en vigueur dans le monde, que ce soit pour le risque "normal"
ou les installations à caractère industriel ou nucléaire, demande
explicitement une approche probabiliste dans l'évaluation de
l'aléa sismique (Agence internationale de l'énergie atomique,
grands barrages, risque normal en France, réglementation européenne
Eurocode 8...). Le DASE travaille depuis de nombreuses années
sur cette méthodologie et dispose aujourd'hui d'un outil opérationnel pour évaluer l'aléa sismique sur un site donné.
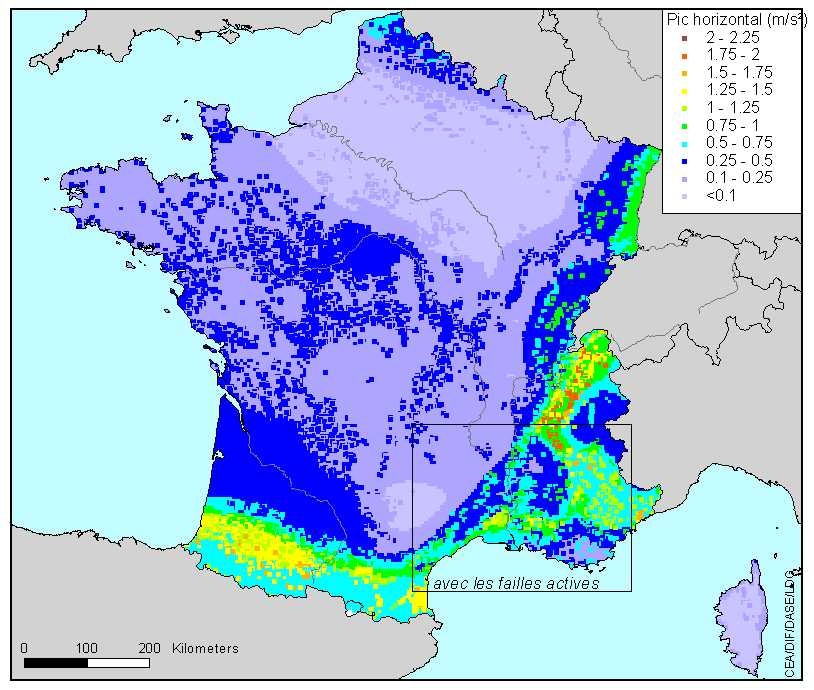
 |
Pic
d'accélération attendu pour une période de retour de 1975
ans en France. |
|
 |
|
 |
 Sismotectonique
et paléosismicité Sismotectonique
et paléosismicité |
 |
|
 |
France |
 |
|
 |
En France, les forts séismes sont peu
nombreux (voir Informations
sur la sismicité) et ne se reproduisent que rarement au
même endroit à l'échelle de la mémoire humaine. On ne peut donc
espérer avoir une image exhaustive de la sismicité potentielle
d'une région à l'aide des seules données de sismicité instrumentale
et historique. La recherche d'indices néotectoniques, de paléoséismes
ainsi que l'exploitation de mesures de déformation (GPS, Global
Positionning System) sont donc des compléments indispensables à
l'analyse de la sismicité passée.
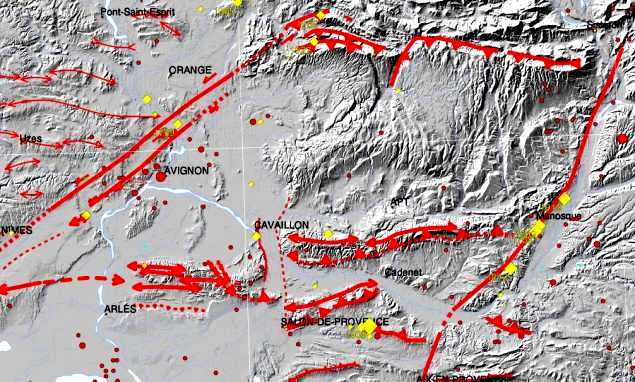
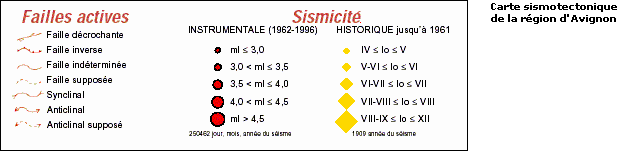
|
 |
|
 |
Mongolie |
 |
|
 |
Le DASE, en collaboration avec le RCAG
(Research Center of Astronomy and Geophysics, Académie des sciences
de Mongolie), a effectué une évaluation du risque sismique
de la région d'Oulan Bator, capitale de la Mongolie, où est
concentrée près de 40 % de la population du pays. Il est à noter
que ce pays a subi quatre séismes de magnitude supérieure ou
égale à 8 depuis 1905.
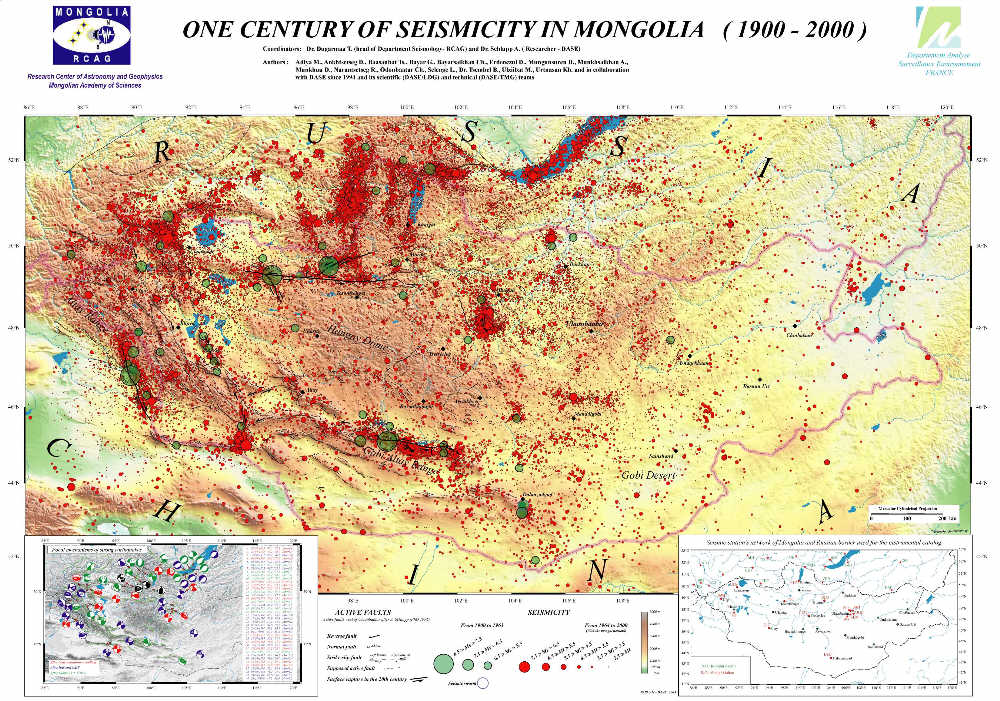
 |
Carte sismotectonique
de la Mongolie. |
Pour mener à bien cette évaluation, la sismicité du pays a été
totalement revue et les lois d'atténuation redéfinies. La carte
obtenue montre notamment que l'activité actuelle signe toujours
les failles qui ont rompu au début du XXème siècle et que
la région proche de la capitale est marquée par une sismicité
modérée. Par ailleurs, les travaux de paléosismicité le long
d'un escarpement de faille montrent que des séismes de magnitude
7 environ peuvent se produire à moins de 200 km de la capitale.
Au niveau du bassin d'Oulan Bator, près de 100 points de mesures
d'effets de site ont été réalisés. Ces données nouvelles sont
intégrées dans la quantification du risque sismique. |
 |
|
 |
 Quelques
réalisations Quelques
réalisations |
 |
|
 |
 |

 |
Etude d'aléa pour les sites CEA
de Cadarache, Grenoble, Marcoule, Saclay, Valduc et CESTA |
 |

 |
Système
d'arrêt d'urgence du TGV Méditerranée |
 |

 |
Etude d'aléa pour le site d'un
barrage de retenue dans le Gard |
 |

 |
Programme d'Evaluation des Risques
Liés aux Effets des Séismes |
 |

 |
Evaluation de la variation du mouvement
sismique avec la profondeur |
|
| |
|
|
|